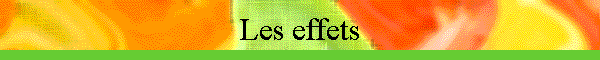
|
|
1. Pour les animaux :1.1. Chez les monogastriques (16) (17) :De nombreuses mycotoxines ont des effets divers chez les animaux monogastriques :
1.2. Chez les ruminants (15) (16):1.2.1. Le devenir des mycotoxines chez les ruminants:Les ruminants possèdent un système digestif de type polygastrique, ils sont donc dotés d’une flore microbienne très importante au niveau du rumen. Il a été démontré que celle-ci était capable de dégrader certaines toxines à faibles doses, grâce à ses micro-organismes, elles deviennent alors plus ou moins toxiques. D’autre part, le rumen bénéficie d’une paroi kératinisée ce qui limite l’absorption les mycotoxines dans le sang. De plus, le rumen est le lieu d’une dilution importante liée à la quantité de sucre salivaire, ce qui limite l’importance des toxines. Devenir des mycotoxines dans le rumen et évolution de la toxicité:
Sources : (15) Il faut préciser que le type d’aliment est aussi un acteur de la dégradation des mycotoxines (elles sont plus dégradées dans une ration riche en concentrés). D’autres transformations ont lieu dans l’épithélium intestinal, le foie et les reins, elles ont plus pour conséquences de diminuer la toxicité et de permettre la solubilisation dans l’eau des mycotoxines, elles sont alors excrétées dans l’urine ou le lait. On a donc une contamination du lait : on retrouve principalement les ochratoxines, les aflatoxines et les ZEN mais les taux de transferts restent faibles: Taux de transfert des mycotoxines dans le lait de bovins:
Sources : (15) Les ruminants sont bien protégés par leur système digestif. On notera toutefois que les ovins seraient plus sensibles que les bovins. Le taux de transfert des mycotoxines dans le lait y serait plus important et poserait plus de problèmes pour les agneaux, ces derniers seraient en danger à partir de 44,5 mg/kg d’aliment pour la FB1. 1.2.2. Les effets sur les ruminants :Le tableau ci-dessus présente les effets probables des principales mycotoxines sur les ruminants. Les études ont montré les effets suivants mais les taux moyens de toxicité n’ont pas été déterminés. Répercussions des différentes mycotoxines sur les ruminants
Ce tableau représente l’action spécifique de chaque mycotoxine mais, leur action est généralement combinée dans les rations ce qui augmente les effets négatifs sur les animaux. Les effets possibles sur les ruminants varient selon quatre critères :
Les mycotoxines provoquent de nombreux effets négatifs sur les ruminants mais ceci lors d’une ingestion en grande quantité et sur des animaux fragilisés. De plus, la contamination généralement s’autorégule par la diminution de l’ingestion. Jusqu’alors, ces pathologies n’étaient pas détectées, ou étaient confondues, il est donc difficile de faire un bilan pathologique précis. La seule conséquence certaine des mycotoxines est la baisse de production laitière, en effet, l’inappétence de la ration contenant des moisissures diminue l’ingestion et donc la production. Les seuils définis sont très variables. Les ruminants possèdent grâce à leur système digestif une protection efficace contre les mycotoxines. 2. Pour l’homme :Du fait de leur concentration dans les denrées alimentaires, on dénombre une vingtaine de mycotoxines potentiellement dangereuses pour l’homme. Cependant, il est rare que les denrées présentent une forte concentration en mycotoxine, entraînant une intoxication aiguë pouvant aller jusqu’à la mort de l’individu. Dans la plupart des cas, l’homme est sujet à des intoxications chroniques de petites quantités de mycotoxines, dont les effets sont rarement dangereux. Les conséquences des mycotoxines sont dépendantes de nombreux facteurs tels que la concentration en toxine, la durée d’exposition ou l’état physiologique de la personne contaminée par exemple. De plus, les mycotoxines sont polymorphes, c'est-à-dire qu’une même mycotoxine n’aura pas les mêmes effets sur l’organisme en fonction de ces paramètres. Ainsi, il est rare que les symptômes soient caractéristiques d’une mycotoxine. Il est donc difficile de connaître tous les effets possibles sur l’homme. Certains sont fortement suspectés d’être dus à la consommation de produits contenant des mycotoxines, mais le manque de données ne permet pas de l’affirmer (32) (34). Sylviane Dragacci, chercheur à l’AFSSA, a dénoncé les multiples effets des mycotoxines pour l’homme, qui peuvent être " cancérigènes, mutagènes, tératogènes, immunosuppresseurs, allergiques, oestrogéniques, nécrosants, neurotoxiques, néphrotoxiques … ". Elle ajoute de plus que " les organes et tissus cibles sont très divers : foie, rein, peau, système immunitaire, système nerveux, glandes endocrines, où des lésions organiques irréversibles peuvent être produites . Les mycotoxines peuvent être classées en trois groupes selon leur effet cancérigène sur l’animal et sur l’homme, d’après le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC). Ce classement a été fait à partir de données issues de travaux épidémiologiques établissant des liens de causes à effets entre la consommation d’aliments contaminés et ses conséquences (16) (31).
Groupe 1: effet cancérigène avéré pour l’homme.
Groupe 2B : effet cancérigène possible pour l’homme (évidences chez l’animal).
Groupe 3 : pas d’effet cancérigène (évidences insuffisantes pour l’animal et évaluation impossible pour l’homme).
Le tableau ci-dessus présente les effets probables des principales mycotoxines sur l’homme. Seule l’aflatoxine a un effet cancérigène certain car elle appartient au groupe 1. Pour les autres mycotoxines, il n’y a aucune étude permettant de l’affirmer. Ces résultats sont à prendre avec précaution. Il serait en effet nécessaire d’entreprendre des études épidémiologiques afin de préciser le rôle de certaines mycotoxines, car comme nous l’avons vu précédemment, de nombreux effets sont supposés. De plus des interactions inter mycotoxines, et ce surtout dans le cas des Trichotécènes peuvent induire un décalage entre les conditions expérimentales et réelles. Effets probables des principales mycotoxines sur l'homme
|