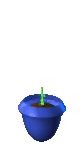 Intérêts
et méthodes de la sélection par haplodiploïdisation
Intérêts
et méthodes de la sélection par haplodiploïdisationRetour à Objectif de la sélection
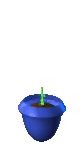 Intérêts
et méthodes de la sélection par haplodiploïdisation
Intérêts
et méthodes de la sélection par haplodiploïdisation
Intérêts
> Obtention de lignées fixées en une seule génération
L'haplodiploïdisation permet de fixer plus rapidement le matériel génétique en cours de sélection, en une seule étape au lieu de 7 à 8 générations. Avec cette méthode, la durée d'un cycle de sélection est raccourcie de 3 à 4 ans.
>
Obtention de plantes homozygotes et de lignées pures
L'haploïdie est une situation génétique naturelle, fugace et non autonome,puisque seuls les gamètes présentent cet état génétique et que leur durée de vie est courte. En doublant ensuite le nombre de chromosomes dans ces cellules, on restaure l'état diploïde normal, mais les deux copies de chaque gène étant identiques , on obtient des plantes homozygotes, fondatrices de lignées pures, alors qu'il faut de nombreuses années par la voie biologique normale.
> L'obtention d'haploïdes doublés
L’haplodiploïdisation par culture in vitro est née en 1964 avec les travaux de GHUA et MARESHWARI sur Datura sp. L’introduction de l’haplodiploïdisation en sélection céréalière présente de nombreux avantages, particulièrement dans le cas de la sélection récurrente, où l’obtention d’haploïdes doublés (HD) à partir de la population n permet de travailler sur du matériel fixé, et de sélectionner plus efficacement les génotypes à intercroiser pour produire la population n+1. Cependant, pour que l’utilisation de l’haplodiploïdisation n’introduise pas de biais en sélection, il faut que tous les génotypes puissent donner une descendance HD, afin de garantir une bonne exploitation de la variabilité génétique.
L’intérêt premier de l’haplodiploïdisation n’est pas le gain de temps mais l’accroissement de l’efficacité du travail de sélection, les caractères récessifs s’expriment immédiatement comme les caractères dominants. Le choix des lignées HD est alors moins aléatoire.
En ce qui concerne le blé tendre (Triticum aestivum 2n=42), différentes méthodes sont utilisées pour obtenir des HD.
Méthodes utilisées pour produire des Haploïdes Doublés (HD)
L’androgenèse est depuis longtemps la méthode la plus utilisée. C’est en 1973 que furent obtenues les premières plantules haploïdes de blé, et en 1975 les premières plantules haplodiploïdes. Récemment, les travaux de LAURIE et BENNETT (1988), ont fait apparaître une autre manière de produire des HD chez le blé, par croisement interspécifique avec le maïs.
Le prélèvement des épis est réalisé au stade « uninucléée intermédiaire » (ou « uninucléé médian ») pour les microspores, c’est à dire juste avant la mitose. Ce stade physiologique est repérable sur l'épi car il se situe aux trois quarts de la gaine.
Microspores au stade uninucléé intermédiaire Épi au trois quarts de la gaine Sources photos personnelles
Les épis récoltés sont ensuite stockés au froid pendant plusieurs jours. Ce stockage s’avère favorable à l’induction (déclenchement des divisions cellulaires conduisant à un cal).
Les épis sont disséqués stérilement sous hotte à flux laminaire et les anthères sont prélevées sous une loupe binoculaire, puis déposées à la surface d’un milieu gélosé.
Les cultures d’anthères sont maintenues à 28°C sous faible intensité lumineuse pendant 40 jours. Dès le 21ème jour les embryoïdes ou cals commencent à apparaître et sont repiqués chaque semaine sur un second milieu dit "milieu de conversion" ou "milieu de régénération" sous un éclairement d’environ 3000 Lux.

Cals ou embryoïdes issus d'anthères source: photos personnelles

Sur chaque plante mère, un épi est castré approximativement 3 jours avant l’anthèse, et recouvert par un sac en plastique permettant le maintien d’une hygrométrie de 100% autour de l’épi. La pollinisation est réalisée 3 jours après la castration avec un mélange de pollen de maïs.
Juste après la pollinisation, une injection de 2-4D est réalisée dans la cavité de la tige située au-dessus de l’entre-nœud. Le lendemain une solution d’acide gibbérellique est pulvérisée sur l’épi. Après cette pulvérisation, le sac en plastique entourant l’épi est remplacé par un sac en papier sulfurisé, pour éviter que le maintien trop prolongé de l’épi en situation d’humidité saturante ne provoque le développement de maladies (en particulier la fusariose).
21 jours après la pollinisation, les épis sont prélevés et les embryons sont isolés des caryopses sous une loupe binoculaire. Les embryons sont placés sur le milieu dit de "régénération", les étapes sont à partir de ce moment-là identiques à celles utilisées pour l’androgenèse.
avec Hordeum bulbosum :
Une autre méthode de croisement interspécifique est couramment utilisée depuis 1973, il s'agit de la méthode bulbosum. Pour celle-ci, les techniques de cultures et de castrations des plantes mères sont identiques aux précédentes, mais les épis castrés sont pollinisés par une orge sauvage : Hordeum bulbosum 2n=14. Très peu de temps après la fécondation, le lot chromosomique de Hordeum bulbosum est éliminé et un embryon haploïde commence son développement sur la plante mère.
15 jours après pollinisation il est nécessaire de prélever les embryons pour les cultiver in vitro. Après stérilisation à l’hypochlorite de sodium, les jeunes grains sont disséqués sous loupe binoculaire et les embryons sont déposés stérilement sur le milieu d’enracinement. En deux semaines les embryons les mieux différenciés donnent naissance à des plantules vertes qui sont alors transférées en chambre de vernalisation pendant 8 semaines (pour le blé d'hiver), puis acclimatées en serre. Lorsque les plantes atteignent le stade 2 ou 3 talles, elles sont arrachées, lavées et immergées dans une solution de colchicine à 0.1% pendant 5 heures puis rincées abondamment, repiquées en serre et cultivées jusqu’à production de graines.
La colchicine
Le traitement à la colchicine a lieu trois jours avant le transfert sur le milieu de conversion dans le but de doubler le stock chromosomique. La colchicine bloque les divisions cellulaires, c’est à dire qu’elle stoppe la mitose à la phase métaphase en bloquant le fuseau de microtubules. Son intérêt précis est de passer de n (microspore haploïde) à 2n pour avoir une plante fertile et viable.
La colchicine bloque la mitose après duplication des chromosomes et les cellules deviennent diploïdes.
Animation interactive de la mitose.
Le traitement à la colchicine peut se réaliser au stade plantule par trempage des racines ou injection dans les méristèmes. Les taux de doublement sont alors très variables. Actuellement, se développent des traitements in vitro au stade embryonnaire.
La colchicine peut avoir des effets directs lors de son utilisation pendant l'induction. En 1991, Hassawi montre que les effets de la colchicine sont trop sévères lorsqu'elle est présente en permanence dans le milieu, l'idéal étant une application de 48 heures après apparition de cals. Hansen se rend compte en 1998 qu'une concentration en colchicine supérieure à 300 mmol.L-1 engendrerait une importante diminution du nombre de plantes fertiles par épi mis en culture. En conclusion, la concentration et la durée du traitement à la colchicine ont des effets sur l'efficacité de la méthode car, du fait de sa toxicité, une grande mortalité est possible.
Deux stades d'application de la colchicine sont possibles :
Après trois semaines de culture, les plantules vertes apparues sont repiquées sur un milieu dit "d’enracinement". Lorsque ces plantes vertes atteignent un développement suffisant, elles sont repiquées en serre, dans des pots individuels contenant du terreau.
Jeunes Plantules de HD Photo : source personnelle
D’autres études (MEJZA 1993) ont montré qu’une production plus importante de plantes vertes était possible, en obtenant des HD à partir de microspores de blé isolées et cultivées en milieu liquide.