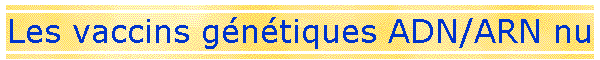
|
|
|
|
Depuis une quinzaine d’années, un nouveau concept dans la vaccination est apparu : l’immunisation génétique. En effet les chercheurs se sont rendus compte que la simple injection dans la peau ou dans le muscle (quelques nanogrammes à 100μg), de gènes codant pour les protéines antigéniques, et insérés dans un fragment d’ADN plasmidique bactérien, permettait d’induire une réponse immunitaire cellulaire et/ou humorale. Il est ainsi possible de construire des vecteurs multiples, comprenant différents gènes codant de multiples antigènes. [6]
L’ADN des vaccins utilise le matériel génétique microbien ; en particulier les gènes qui codent pour les antigènes importants. L’ADN dans ces vaccins est circulaire comme celui des plasmides. Source NIAID [22] A la suite de l’injection, l’ADN pénètre dans la cellule musculaire qui va ensuite synthétiser l’antigène de manière locale. Cette méthode de vaccination, simple et peu coûteuse, a beaucoup d’avantages : l’antigène produit est souvent sous sa forme originelle et donc semblable à celui synthétisé lors d’une infection. De plus il est produit durablement par la cellule évitant le recours aux rappels pour certains vaccins.
Les vaccins recombinants utilisent une cellule microbienne pour délivrer leur matériel génétique à l’origine de la maladie. Le matériel génétique contient le code pour fabriquer le vaccin à antigène dans les cellules du corps, utilisant ces cellules usines. Sources : NIAID [22] Il est
stable à température ambiante et ne nécessite pas de chaîne du froid. Enfin
il n’y a aucun risque d’infection post-vaccinale, ce qui est important pour
les individus immunodéprimés. Il reste cependant à évaluer le risque d’intégration
de l’ADN introduit dans les cellules de l’organisme avant son utilisation à
grande échelle. Pour cela il convient d’éviter l’utilisation de régions
homologues avec l’ADN de l’hôte. De plus un autre aspect important à
considérer est la possibilité d’induction de tolérance ou d’auto immunité.
On a remarqué que l’âge de la souris au moment de l’injection y jouait un
grand rôle. Une nouvelle voie de recherche est la combinaison des vaccins à ADN et des vecteurs bactériens. En effet, plusieurs systèmes bactériens tels que Shigella, Escherichia coli et Salmonella, sont actuellement en voie de développement pour délivrer l’ADN nu par application mucosale. Avec ses atouts, la vaccination par l’ADN suscite beaucoup d’intérêts et de travaux sur de nombreuses maladies : le sida, la tuberculose, le paludisme, l’hépatite B, la rage, l’herpès…
|
|
|